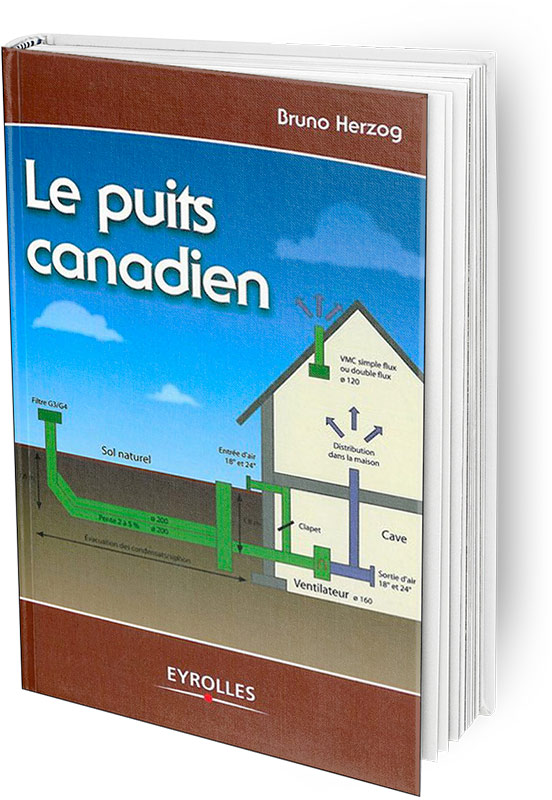Qu’est-ce qu’un Puits Canadien ? Principe, Fonctionnement, Avantages et Inconvénients
Le puits canadien, aussi appelé puits provençal, est un système de ventilation géothermique de plus en plus prisé dans les foyers français. En effet, offrant une solution pratique, écologique et économique, il permet de se passer de climatisation, d’aider à réduire nos dépenses énergétiques efficacement et de bénéficier d’un air sain chez nous en toute saison.
Toutefois, si ce puits climatique se popularise, il reste assez méconnu. Principe, avantages et inconvénients du puits canadien, prix, durée de vie, etc, avant de se lancer dans l’installation d’un tel dispositif, il est essentiel de comprendre comment il fonctionne et quel est son intérêt pour vous.
Vous êtes intéressés par le puits canadien ou provençal ? BatirBio vous explique tout sur ce dispositif géothermique de ventilation :
- Qu’est-ce que le puits canadien ?
- Quel est le principe du puits canadien ?
- Comment fonctionne le puits provençal ou canadien ?
- Neuf ou rénovation : quand procéder à l’installation d’un puits canadien ?
- Quels sont les avantages du puits canadien ?
- Quels sont les inconvénients du puits canadien ?

Qu’est-ce que le puits canadien ?
Le puits canadien est un dispositif géothermique (utilisant la chaleur du sol pour la transformer en énergie) de ventilation et de circulation de l’air qui permet, grâce à un réseau de canalisations enterrées, de réchauffer ou refroidir un bâtiment et d’obtenir une température idéale toute l’année. Il permet aussi de conserver un air sain ambiant, le renouvelant de manière constante.
Le puits canadien, ou puits provençal, se base sur un concept existant depuis l’empire romain, qui permettait, grâce à une cave ou à un puits, de faire pénétrer l’air froid dans les maisons lors des périodes chaudes. Aujourd’hui, ce type de chauffage canadien est l’un des rares dispositifs à fournir plus d’énergie qu’il n’en consomme, même avec un usage continu.
Quelle est la différence entre un puits canadien et un puits provençal ? Le puits canadien correspond au préchauffement de l’air dans les canalisations en hiver, tandis que le puits provençal correspond au refroidissement de cet air en été. Le dispositif de régulation reste ainsi le même.
Il faut noter que le puits provençal ou canadien n’est pas un système de chauffage ou de climatisation, mais un dispositif de ventilation. Il ne peut donc pas servir de seul système de chauffage, ne pouvant couvrir tous les besoins. Toutefois, c’est un dispositif complémentaire idéal pour obtenir un air tempéré et confortable, et faire des économies.
Quel est le principe du puits canadien ?
Le puits canadien capte l’air neuf extérieur, le fait circuler dans des canalisations enfouies dans le sol et, selon la saison, le réchauffe ou le refroidit, avant de le distribuer dans l’habitat. Basé sur l’écart de température air-sol (dû à l’inertie thermique du sol), il régule naturellement la température captée et assure un air sain, confortable et renouvelé.
En effet, il existe une grande différence entre la température extérieure de l’air (variant entre -20° et 35°), et la température du sol, qui a tendance à rester constante (entre 10° et 18°). Ainsi, en hiver, l’air extérieur est plus froid que la température au sol, et en été, l’air extérieur est plus chaud.
Toutefois, il faut noter que, pour que le puits canadien soit performant, il faut que le bâtiment ciblé soit également performant. En effet, un puits provençal aménagé pour une maison passive ou pour un bâtiment optimisé au point de vue climatique (isolation et étanchéité optimale) sera beaucoup plus performant que pour une maison mal conçues (qui sera un gouffre à énergie).
Comment fonctionne le puits provençal ou canadien ?
Le fonctionnement du puits canadien ou provençal va dépendre du type de puits climatique installé : puits canadien aéraulique (à air) ou puits canadien hydraulique (à eau glycolée).
Le puits provençal ou canadien aéraulique
Le puits canadien aéraulique est le puits provençal traditionnel et le plus répandu, faisant circuler l’air extérieur par des conduits enfouis dans le sol. Il est le plus souvent proposé sous forme de kit de puits canadien LEWT, composé de :
- Borne de prise d’air extérieur : bouche d’aspiration qui capture l’air extérieur et l’assainit avant de le faire passer dans les canalisations, pour une qualité d’air remarquable. Elle dispose d’une grille et d’un filtre G3/64 (bloquant insectes, pollen, rongeurs, prolifération de bactéries et champignons, etc.). Cette prise doit avoir une hauteur minimale d’1m40 et doit être éloignée de toute source de pollution,
- Conduits enterrés : réseau de canalisations enterrées en extérieur. D’un diamètre de 20 cm environ, ils doivent être installés en pente légère (supérieure à 2 %) avec un siphon pour faire circuler l’air et évacuer les condensats (eau liquide obtenue par la condensation de sa propre vapeur pouvant entraîner la formation de moisissures et d’humidité résiduelle).
- Ventilateur : le puits canadien se couple le plus souvent avec un ventilateur VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) pour accroître ses performances et l’apport de chaleur (ou de fraîcheur, pour le puits provençal). Pour être efficace, ce ventilateur sera à double flux, permettant de réguler l’humidité, la température et la qualité de l’ambiance intérieure, et de rejeter l’air vicié,Les conduits, le plus souvent en polyéthylène ou en fonte, doivent être enfouis à une entre 2 m et 3 m de moyenne (le plus souvent 2 m), pour un rendement optimal. La longueur du puits canadien doit être d’environ 30 m à 50 m de distance de l’habitat. Les conduits doivent aussi passer à 2 mètres environ des arbres et arbustes, être éloignés des zones de stationnement et ne pas passer sous le bâtiment ou l’habitation (au risque de capter la chaleur de la maison et de la refroidir). Enfin, les raccords de conduits doivent être étanches, pour empêcher l’immersion de radon. Avec BatirBio, vous avez l’assurance de raccords 100 % étanches.
- By-pass : clapet motorisé piloté par une sonde thermique qui permet de faire basculer le système en puits canadien ou puits provençal selon les saisons. Mesurant la température extérieure et celle du puits, le By-pass permet aussi de court-circuiter le système à l’intersaison, en choisissant la température la plus judicieuse. Il est essentiel de bien mettre en place son By-pass, au risque d’appauvrir le sol dans lequel se trouve le puits canandien,
- Regard de visite : ouverture permettant d’inspecter facilement l’état et le fonctionnement du puits canadien, et de récolter les condensats (qui seront conservés dans un puisard puis renvoyés à l’air extérieur). Ce regard de visite doit être d’une ouverture minimale de 300*100 mm et être parfaitement étanche.
Le puits canadien hydraulique
Le puits canadien hydraulique est un chauffage canadien, qui, au lieu de véhiculer de l’air, va véhiculer de l’eau, à l’aide d’un échangeur air-eau (servant au préchauffage de l’air en hiver et de son rafraîchissement l’été). Il est composé d’une boucle d’eau glycolée, faisant office de fluide caloporteur en circuit fermé, empêchant ainsi la givre de l’échangeur. Il prend alors la forme de kit de puits canadien SEWT.
Si le puits canadien hydraulique est un système plus simple que le puits aéraulique (pas d’exigence de pente, pas de borne de prise d’air ou de regard de visite nécessaire), il est cependant moins performant qu’un puits aéraulique, avec une puissance moindre et le besoin d’un débit d’eau important pour que l’échangeur soit efficace.
De plus, requérant ainsi l’installation d’un échangeur air / eau, d’une pompe supplémentaire et de tranchées beaucoup plus longues (au moins 400 mètres de réseaux), le puits canadien hydraulique sera plus cher et plus compliqué à installer.
Le puits hydraulique est, de ce fait, une solution à privilégier lorsqu’il est impossible d’installer un puits provençal classique, comme en cas de roche présente sur le terrain.
Neuf ou rénovation : quand procéder à l’installation d’un puits canadien ?
De manière générale, l’installation d’un puits canadien doit être prévue lors de la construction de la maison ou du bâtiment. En effet, pour que le puits soit réellement performant, il est essentiel de concevoir dès le départ un bâtiment qui le soit aussi. Avec une maison passive, le puits canadien, avec une VMC double flux, pourra couvrir rapidement les faibles besoins en énergie nécessaire.
De plus, s’il est planifié dès la conception du projet, ce chauffage canadien sera plus facile à installer, pouvant prendre en compte toutes les données importantes. Notamment, il sera facile de prendre en compte le calcul en amont de la surface à couvrir, le climat, le type et la qualité du sol, la qualité de l’isolation, la profondeur du puits canadien idéale, la pose de la VMC, etc.
À l’inverse, en rénovation, la performance du puits provençal va dépendre de la performance du bâtiment. Si le bâtiment est gourmand en énergie (avec la présence de ponts thermiques), le puits ne sera pas aussi performant et ne permettra pas de réduire efficacement ses dépenses énergétiques.
De plus, l’installation du puits provençal sera beaucoup plus lourde et compliquée à réaliser. Une fois le terrain aménagé (position du bâtiment, présence d’arbres, d’un jardin ou potager, d’une piscine ou d’une zone de stationnement, etc.), les possibilités de placement et de pose seront plus limitées, et surtout, les travaux seront beaucoup plus lourds.
Vous souhaitez installer un puits canadien dans votre maison ou bâtiment ? Contactez BatirBio conseiller en thermique, qui pourra réaliser une étude thermique PHPP et concevoir et fabriquer sur mesure le puits canadien ou provençal parfaitement adapté à vos besoins. Et avec notre régulation DeltaTero, vous optimisez tous vos apports énergétique, gérant automatiquement votre ventilation, été comme hiver.
Puits canadien hydraulique ou aéraulique, dimensionnement et mise en place, nous vous accompagnons de A à Z !

Quels sont les avantages du puits canadien ?
Dispositif très pratique, le puits canadien ou provençal possède de nombreux avantages. C’est notamment une solution :
- Écoresponsable : c’est une solution naturelle et écologique pour réguler la température chez soi, en réduisant l’impact sur l’environnement et sur ses habitants. N’utilisant que l’air extérieur et la température du sol, il offre en plus une énergie propre, gratuite et inépuisable,
- Économique : possédant un coût faible en énergie, le puits canadien permet de limiter ses besoins en chauffage ou climatisation et de réduire sa consommation. Cependant, sa performance sera proportionnelle à la performance énergétique de la maison. En cas de maison passive, un puits canadien peut par exemple faire économiser jusqu’à 70 % de réduction sur ses factures énergétiques,
- Polyvalent et confortable : il s’adapte à tous les besoins, en toute saison. En hiver, le puits canadien assure un air chaud, et en été, un air frais (écrêtant ainsi les pics chauds et froids), pour un confort thermique idéal toute l’année. De plus, la VMC renouvelle l’air en fonction des besoins du bâtiment, garantissant une qualité d’air remarquable constante.
- Performant : si sa consommation d’électricité est faible, ses performances sont très élevées avec un coefficient de performances (COP) entre 10 et 30. Cela signifie que pour 400W consommés en 1h, le puits provençal peut restituer jusqu’à 5.000W dans le même temps (avec 3 conduits de 50 m. Une fois installé, son niveau d’efficacité en fait le nec plus ultra du domaine,
- Rentable : selon le type de chantier, la performance de la maison et la qualité des équipements, un puits canadien peut coûter entre 1.500 € et 4.000 €, hors frais d’ingénierie et de terrassement, ce qui en fait un système très rentable, notamment par rapport au prix d’une climatisation. De plus, ce type de puits peut avoir une rentabilité assez rapide, entre 5 et 8 ans, offrant ainsi un retour sur investissement très intéressant, surtout dans le contexte actuel de l’explosion du coût de l’énergie,
- Durable : la durée de vie du puits canadien est très grande, avec une absence d’usure du puits et des équipements très résistants pouvant durer autant que le bâtiment. Ce puits climatique demande aussi peu de maintenance : nettoyage des filtres de la prise d’air et du double flux et nécessaire tous ans environ (ou tous les 6 mois en cas de forte pollution). Avec notre régulation DeltaTero, vous êtes informés de l’encrassement des filtres sur le moment,
Adaptable : ce type de puits est compatible avec d’autres dispositifs de chauffage, et, dans certains cas de figure, de climatisation (en accouplant par exemple une pompe à chaleur avec un groupe froid pour augmenter la performance du puits canadien.

Quels sont les inconvénients du puits canadien ?
Le puits canadien ne possède pas d’inconvénients à proprement dit. Cependant, afin de vous assurer d’une bonne installation (dimensionnement et pose) et d’un fonctionnement performant et durable (qualité d’air parfaite, température confortable, etc.), il est essentiel de passer par un professionnel.
En effet, si installer un puits canadien fait maison est possible, cela requiert une expertise et le respect de normes. Le puits provençal doit notamment respecter les normes énergétiques RE2020, requérant une étude préalable réalisée par un professionnel.
De plus, un puits canadien artisanal mal installé peut entraîner la présence de condensats (si le puits n’est pas installé sur une pente douce), une dégradation prématurée, le risque de gaz radon (en cas de conduits non étanches), qui risquent de coûter très cher.
Vous savez maintenant tout sur les puits canadiens. Pour vous assurer le meilleur puits climatique, faites confiance à BatirBio ! Notre équipe d’experts vous accompagne dans votre projet et vous garantit les meilleurs résultats. Et si vous souhaitez installer un puits canadien fait maison, faites appel à notre expertise pour vous aider dans vos démarches d’auto-constructeur.
Connaissance
A quoi sert un puits canadien ? – Quelle est l’utilité d’un puits canadien et quel est son principe de fonctionnement ? Est-ce un système efficace pour économiser de l’énergie ?
Chauffer sa maison avec un puits canadien – L’intérêt d’installer un tel système est aussi de faire des économies de chauffage.
Puits climatique : la famille du puits canadien – Sur quel principe fonctionne la famille des puits climatiques ? Quelle est la source d’énergie les alimentant ?
Puits canadien : quels matériaux pour le meilleur rapport ? – Y’a-t-il des matériaux à privilégier pour construire un puits canadien ? Permettent-ils un meilleur rapport coût/efficacité ?
Rendement du puits canadien à eau glycolée – Le puits canadien à eau glycolée est-il aussi efficace que le puits canadien « classique » ? Représente-t-il un réel avantage ?
Rendement d’un puits canadien équipé d’une VMC double flux – Quel rendement peut-on espérer d’un puits canadien équipé d’une VMC double flux ? Existe-t-il un dispositif plus performant ?
Puits canadien et RT2012 – Le puits canadien s’inscrit-il dans la démarche écoresponsable qu’entend faire respecter la réglementation thermique 2012 ?
Réglementation thermique rt2020 et puits canadien – Quel intérêt représente le puits canadien pour une construction rt2020 ? Permettra-t-il de valoriser la construction ?
Puits canadien : quelle efficacité ? – Quelle efficacité peut-on espérer d’un puits canadien bien conçu ? Suffit-il à chauffer une maison ?
Calculer le rendement d’un puits canadien – Comment se calcule le rendement d’un puits canadien et sur quels facteurs s’appuie-t-on ?
Géothermie à partir d’un puit – Comment la géothermie est-elle exploitée avec l’installation d’un puits canadien ? Comment mettre à profit la chaleur du sol ?
Le puits canadien dans le tertiaire – Le puits canadien est un système particulièrement bien adapté aux constructions de type tertiaire.
Puits canadiens et provençaux : où trouver un guide d’information – Où trouver de la documentation pour se renseigner sur les puits canadiens et provençaux ? Comment obtenir des renseignements ?
Quel est l’avantage d’un puits canadien l’été ? – Le puits canadien représente-t-il un avantage seulement en été ? Permet-il également de réduire l’utilisation du chauffage ?
Cas d’utilisation
Étude de cas d’un puits canadien – Quels sont les bénéfices potentiels à tirer de l’installation d’un puits canadien ? Passons les en revue avec une étude de cas.
Étude d’un puits canadien – Comment un puits canadien fonctionne et quels résultats peut-on espérer en termes d’économie d’énergie ?
Principe du puits canadien et cave – L’application du concept du puits canadien est tout à fait adaptée à la ventilation d’une cave.
Pourquoi privilégier un puits canadien pour sa cave à vin ? – Vous êtes féru de bon vin et aimeriez vous offrir la meilleure cave à vin possible ? Découvrez pourquoi le puits canadien y contribuera.
Un puits canadien pour chauffer une serre – Le puits canadien est un système économique et écologique pour chauffer sa serre. Encore faut-il qu’il soit bien réalisé.
Association/Couplage
Associer un puits canadien et un chauffe-eau thermodynamique – Quel gain peut-on attendre de l’association d’un chauffe-eau thermodynamique et d’un puits canadien ?
Chauffe-eau thermodynamique sur puits canadien – Pourquoi et comment on peut installer un chauffe-eau thermodynamique en relation avec un puits canadien.
Couplage d’une PAC et d’un puits canadien – Examinons les différents aspects du couplage d’une pompe à chaleur avec un puits canadien.
VMC double flux couplée à un puits canadien – Est-ce que coupler une VMC double flux à une puits canadien représente un avantage ? Existe-t-il une solution plus performante ?
Puits canadien couplé à une VMC double flux – Quel avantage représente l’installation d’une VMC double flux sur un puits canadien? Quel en est le bénéfice ?
Différence entre géothermie et puits canadien – La géothermie et le puits canadien sont deux concepts très différents même si trop souvent confondus. Voyons tout ceci de plus près.
Puits canadien et pompe à chaleur : la différence – Un puits canadien et une pompe à chaleur ne sont pas opposables, ils sont même complémentaires.
Différence entre puits canadien et puits provençal – Quelle différence existe-t-il entre un puits canadien et un puits provençal ? D’où tirent-ils leur origine et quelle est leur utilité ?
Puits canadien hydraulique avec VMC double-flux – Les pièges de l’association d’un puits canadien hydraulique et d’une VMC double-flux, ainsi que quelques pistes de solutions.
Installation
Schéma d’un puits canadien à VMC double flux – Quels sont les principaux éléments d’un puits canadien ? Quels composants sont visibles sur un schéma ?
Quel type de tuyau pour construire un puits canadien ? – Vous aimeriez savoir quel type de tuyau utilisé pour la construction de votre puits canadien ? Voici quelques conseils pratiques qui vous aideront dans votre choix.
Quelle longueur de tuyau dans le sol pour un puits canadien ? – Quelle dimension le réseau de tuyaux sous-terrain doit atteindre pour qu’un puits canadien soit efficace ?
Puits canadien : quelle est la profondeur idéale ? – Si vous ne savez pas quelle profondeur choisir pour l’installation de votre puits canadien, découvrez comment procéder pour la choisir.
Dimensionner un puits canadien hydraulique – Un puits canadien hydraulique demande un dimensionnement informatique précis.
Combien coûte l’installation d’un puits canadien ? – Quel budget faut-il prévoir pour l’installation d’un puits canadien ? Les travaux sont ils rapidement amortis ?
Construire, pas à pas, un puits canadien couplé à une VMC – Est-il possible de construire soi-même un puits canadien couplé à une VMC double flux ? Quelles sont les étapes importantes à respecter ?
Calculer la longueur d’un puits canadien – Le calcul du dimensionnement d’un puits canadien est complexe. Peut-il influer sur les capacités du dispositif ?
Fabriquer soi-même son puits canadien pour sa maison – Quand on construit soi-même un puits canadien pour équiper sa maison, quelles sont les erreurs à éviter ?
Installation d’un puits canadien à eau glycolée – Les différentes phases et travaux que vous rencontrerez pour l’installation d’un puits canadien à eau glycolée.
Installation d’un puits canadien dans une maison ancienne – Installer un puits canadien dans de l’ancien est simple, économique et écologiquement élégant. Voyons pourquoi.
Installation d’une VMC double flux avec un puits canadien – Quels avantages représente l’installation d’une VMC double flux associée à un puits canadien ? Est-ce que cela rend l’installation plus rentable ?
Puits canadien et caisson VMC double flux : kit pour maison – Est-ce que les kits de puits canadien représentent une option intéressante pour réaliser une installation ? Comprennent-ils une VMC double flux ?
Associer une pompe à chaleur et un puits canadien – On peut très bien associer un puits canadien avec une PAC pour en optimiser les conditions de fonctionnement.
Peut-on utiliser une gaine TPC pour faire un puits canadien ? – Est-ce que la gaine TPC est utilisable pour la construction d’un puits canadien ? Existe-t-il d’autres matériaux plus efficaces ?
Entretien
Comment nettoyer son puits canadien ? – L’installation en partie sous-terraine du puits canadien nécessite quelques astuces pour assurer sa maintenance tout au long des saisons.
Filtres pour bornes de puits canadien 200 mm – Quel type de filtres doit-on installer sur une borne de puits climatique en diamètre 200 mm ? Quelle importance cela représente-t-il ?
La gestion de l’hygrométrie par un puits canadien – Le puits canadien est un système simple qui améliore naturellement l’état hygrométrique de votre habitation.
Où trouver un tuyau en polyéthylène pour puits canadien ? – Pourquoi le polyéthylène est-il la matière la plus recommandée pour réaliser un réseau de tuyaux souterrain dans un puits canadien ?
L’évacuation des condensats dans un puits canadien – Comment sont traités les condensats dans un puits canadien ? Que faut-il prévoir pour en assurer une bonne évacuation ?
Puits canadien ou tunnel de galets : comparaison – Quelle différence y a-t-il entre un puits canadien et un tunnel de galets pour profiter de l’inertie thermique du sol ?